La rentrée qui inquiète les enseignants
"A quelques jours de la rentrée, dans certains cantons, et au moment d’un vaste renouvellement des ministres romands de l’école, les représentants des enseignants disent leur inquiétude. Ils interpellent les conseillers d’Etat: ceux-ci doivent «maintenir et faire grandir encore la flamme de la coordination et de la qualité de l’école en Suisse romande», exige le Syndicat des enseignants romands (SER). Devant les médias mercredi, ses responsables ont précisé leurs craintes: le navire scolaire romand pourrait tanguer, et l’harmonisation des systèmes scolaires être freinée.
La politique, d’abord. Président du SER, Georges Pasquier salue «l’arrivée de novices dans cet aréopage» qu’est la Conférence latine des directeurs de l’instruction publique. Parmi les six francophones, quatre ont ou vont changer. Philippe Gnaegi à Neuchâtel et Claude Roch en Valais, ont laissé la place à Monika Maire-Hefti et Oskar Freysinger. A Fribourg, Isabelle Chassot quitte son poste, et à Genève, Charles Beer ne se représente pas. Coup de sac, assorti d’un «problème de leadership»; les deux doyennes de la Conférence, la Vaudoise Anne-Catherine Lyon et la Jurassienne Elisabeth Baume-Schneider, l’ont déjà présidée. Les enseignants romands demandent que «certaines valeurs» continuent de dicter les choix politiques en matière d’école. Notamment, la volonté d’harmonisation. Si le SER a par principe toujours soutenu le rapprochement des systèmes scolaires, les enseignants, eux, s’en sont longtemps méfiés. Leur organisation se fait ainsi le défenseur de l’harmonisation, face à des politiques dont elle craint la volatilité.
L’école romande s’organise désormais en trois cycles, deux primaires, dès quatre ans, et un secondaire, de la 9e à la 11e année. Cette rentrée sera marquée par l’entrée en vigueur, en partie, du Plan d’études romand, dit PER. Contrairement à l’ancienne pratique, où le plan d’études faisait office de feuille de route pour l’enseignant, le PER introduit des objectifs de formation, formulant les compétences que doivent acquérir les élèves, et qui seront contrôlées par des épreuves de type PISA à l’échelle de la Suisse romande. Les apprentissages des enfants sont organisés dans des groupes de disciplines (langues, maths et sciences de la nature, sciences humaines et sociales, etc.), ainsi que la formation générale et des «capacités transversales» telles que la collaboration ou la communication. «Cela introduit une façon de travailler avec les élèves qui ne repose plus sur le fait de tourner les pages d’un manuel», illustre Didier Jacquier, à la tête de la Société pédagogique valaisanne.
«Le PER est un bon outil, et nous avons de l’avance sur nos collègues alémaniques», note George Pasquier (lire ci-contre). Toutefois, «au moment de la mise en œuvre, il y a comme un repli cantonal». Ses collègues racontent de grandes différences de dotations horaires. Des branches sont enseignées avec de fortes variations, malgré la volonté d’harmonisation de départ. Les enseignants font état de «vraies difficultés de coordination» en matière de manuels et autres supports de cours. Le Vaudois Jacques Daniélou cite le cas de l’histoire, dont les moyens d’enseignement sont loin d’être semblables. Et «la dépendance envers [les éditeurs] étrangers empêche toujours d’avoir des moyens adéquats pour certaines disciplines», ajoute le secrétaire général du SER, Jean-Marc Haller.
Ces soucis pratiques se retrouvent dans l’épineuse question des langues. L’une des principales innovations est l’introduction de l’anglais plus tôt, dès la 7e année selon le nouveau système, soit vers 10-11 ans. Or, cette langue «passe mieux auprès des jeunes, et bénéficie de l’attrait de la nouveauté», relève Georges Pasquier. Elle bénéficie aussi d’une méthode moderne, «très appréciée», qui accroît la différence avec le moyen «traditionnel» encore employé pour l’allemand. Les enseignants redoutent que l’allemand ne soit «plombé» par cette introduction avancée de l’anglais." (source :letemps.ch, 15 août 2013)






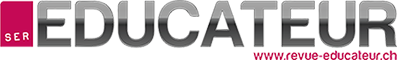

 Facebook
Facebook


