"L’attente vertigineuse de la rentrée" (Le temps)
Au comble de l’angoisse avant la rentrée scolaire, les enseignants répètent, en guise de mantra: «Nous faisons le plus beau métier du monde.» Encore que, reconnaissent-ils, son crédit s’est effrité.
Ce lundi, les élèves et leurs professeurs retournent à l’école à Genève et en terre vaudoise. Une poignée de maîtresses et un maître se livre à deux jours de la nouvelle année qui donne le vertige. On va les appeler Françoise, Nicole, Julie et Bertrand. Des noms fictifs pour des vrais enseignants qui s’expriment ainsi plus librement. Les quatre officient dans différents établissements vaudois. Françoise au primaire, Nicole et Bertrand au secondaire, Julie dans un gymnase. Ils ont la trentaine et une dizaine d’années d’expérience.
Ces voix parlent à la première personne. Elles renvoient pourtant aux doutes, aux interrogations, aux éclats des 8000 professeurs vaudois, voire des 20 000 romands. Avant de les écouter, on avait imaginé que les élèves indisciplinés, les incivilités, sinon la violence dans les préaux allaient hanter leurs confidences. Le quatuor évoque ces questions. Mais l’essentiel est ailleurs, même quand ils exercent dans un établissement dit «difficile».
Françoise, Nicole, Julie et Bertrand regrettent surtout le poids de l’institution, des règlements qui tuent la spontanéité, l’esprit d’initiative, l’envie de bien enseigner. «Pour se promener sur les quais avec des petits enfants du primaire, il faut un brevet de sauvetage», caricature à peine Françoise. La peur du «recours» des parents pour une sanction ou une note insuffisante est omniprésente. «Alors on bétonne tout», assène Julie. Tous fustigent des autorités directives, déconnectées de la vie quotidienne des classes.
Françoise blâme les nouveautés incessantes: «Il y a toujours un manuel plus récent, une méthode inédite. A chaque fois, il faut se familiariser, intégrer les innovations.» Nicole censure les réformes permanentes et surtout la pénurie de moyens pour les réussir. «L’économie prime sur la pédagogie», frappe la maîtresse avec une formule inoxydable.
La nouvelle loi vaudoise sur l’enseignement obligatoire (LEO) focalise l’amertume. Les enseignants jugent sévèrement sa mise en œuvre. Les critiques tranchent avec l’optimisme des autorités scolaires vaudoises communiqué mardi dernier lors d’une conférence de presse. Il y a des problèmes, on s’emploie à améliorer la situation. Les directeurs, les doyens et les enseignants collaborent pour accomplir cette mutation capitale et corriger le tir quand c’est indispensable. Voilà, en gros, le message diffusé.
Plus sombres, les quatre soulignent la solitude de l’enseignant face aux élèves, aux collègues, aux parents. «Les occasions et les lieux de parler, d’échanger, de superviser notre activité font défaut. Nous avons créé de notre propre chef un groupe de rencontre dans notre établissement pour pallier ce manque, note Françoise. S’entretenir avec les doyens tient de la gageure tant ils sont absorbés par des tâches administratives et d’organisation.»
Contre les détracteurs qui leur reprochent treize semaines de vacances et le confort de la fonction publique, Julie rappelle le corps-à-corps incessant avec la matière pour être à la hauteur. «Serai-je prête?» se demande à chaque rentrée la professeure d’allemand. Nicole brandit son engagement total, jusqu’à mettre en danger sa santé. «La pire des choses qui peut vous arriver, bondit encore Françoise, c’est la lassitude et la démotivation. Vous en tombez malade et vous devenez un mauvais enseignant.» Elle sait de quoi elle parle, elle qui a frôlé le burn-out il y a deux ans.
Une enquête en ville de Zurich, qui n’a pas été rendue publique mais dont les résultats ont été éventés par le Tages-Anzeiger en juin dernier, relevait une fois de plus le malaise des enseignants. Même les policiers, indiquait l’étude, se sentiraient moins stressés que les profs. Le phénomène est connu. Les recherches sur le bien-être des maîtres et maîtresses, comme des éducateurs, ont toujours mis en évidence le risque puissant de déprime, d’épuisement intrinsèque à la profession.
A la reprise des cours, fin août, il n’est pas surprenant alors que la «joie» de recommencer se mêle à l’appréhension. Rien de plus normal, avance Julie. Par contre, le climat s’est quelque peu alourdi. Nicole a toujours «bien aimé les rentrées, qui promettent découvertes et expériences enrichissantes. C’est du stress positif. Mais depuis deux ans, trop de choses arrivent en même temps.» L’harmonisation des cursus entre les cantons (HarmoS), le nouveau plan d’études romand (PER), l’introduction très médiatisée de l’allemand dès la 5e primaire et de l’anglais en 7e et la LEO dans le canton de Vaud bouleversent l’école. L’évocation de la rentrée se change en réquisitoire. La nouvelle loi scolaire en prend pour son grade. L’avalanche de nouveautés à digérer provoque le rejet. Sans parler des missions éducatives, source de controverses, qui enflent à côté des apprentissages.
Les responsables des réformes accusent les enseignants d’être conservateurs. Eux s’en défendent. Nicole a voté contre la LEO acceptée par les citoyens vaudois lors du scrutin populaire de 2012. «Je pouvais être d’accord sur le principe de mieux intégrer les élèves, de réduire le cloisonnement entre les filières de dernier cycle de l’école obligatoire, le secondaire I. Les élèves se partagent désormais en deux voies, l’une prégymnasiale, l’autre générale, au lieu de trois auparavant. Par contre, au fil des discussions, j’ai pris conscience que nous n’aurions pas les ressources nécessaires à réaliser les objectifs.»
En réalité, c’est la précipitation qui dérange. «Pourquoi ne pas prendre le temps de se préparer, de se doter des outils de travail, d’engager les ressources nécessaires? A la place, on nous inonde de directives, parfois en retard. L’année passée, nous avons reçu celle sur l’enseignement de l’allemand au mois d’octobre, relève sans rire Nicole. J’ai parfois l’impression d’être fliquée.»
La maîtresse ne peut pas cacher sa frustration. «Avec la nouvelle organisation, il est plus compliqué de suivre les élèves les plus faibles rassemblés dans cette deuxième filière. J’ai vécu des moments très durs l’année passée, avoue-t-elle. Dans mon établissement, on compte une vingtaine de redoublants en 9e année de la voie générale sur 90 écoliers. Je suis certaine que si on avait pu les encadrer correctement, on aurait évité quelques échecs. Le Département de la formation se félicite du 2% de mobilité d’une voie à l’autre enregistré pour ce premier exercice. Comparé au nombre de redoublements, je me demande si cela valait la peine de tout bouleverser.»
Face aux cris d’alarme des syndicats professionnels, les autorités scolaires ont pris des mesures, mais «ce ne sont que des sparadraps, regrette Nicole, à l’image de la période qui sera dorénavant consacrée à la gestion de classe au sein de la voie générale. En réalité, la réforme a affaibli le rôle des maîtres de classe à l’égard des élèves en difficulté. Comment aider les plus démunis avec des effectifs plus importants que dans l’ancienne filière où se retrouvaient ceux qui avaient les moins bons résultats scolaires?» L’appel à ouvrir une classe supplémentaire dans son établissement est resté lettre morte, se désole la généraliste, autrefois institutrice.
«De plus en plus d’élèves ont des besoins particuliers, constate Nicole. Nous devons les intégrer, recommande le département. Or, dénonce-t-elle, les structures sont restées les mêmes qu’auparavant. Je voudrais différencier mon enseignement, je ne peux pas.» Françoise rapporte le cas exemplaire d’un enfant avec des troubles graves qu’elle a dû accompagner pendant deux ans pratiquement sans soutien professionnel, au détriment des autres élèves de la classe.
Bertrand enfonce le clou: «Il n’est pas normal de se reposer uniquement sur la bonne volonté des enseignants.» Pour le prof de français, le contrôle des absences est devenu un casse-tête emblématique. «Personne n’imaginait que ce serait aussi chaotique. Les élèves passent d’une salle à l’autre en raison des niveaux d’enseignement du français, de l’allemand et des mathématiques de la voie générale. Des dizaines d’intervenants sont impliqués. Au bout du compte, on perd pied. Nous ne disposons pas d’un outil informatique pour accomplir cette tâche. Il a fallu bricoler des solutions maison. Si à cela on ajoute des horaires de saltimbanque afin de satisfaire toutes les exigences, on comprend notre mauvaise humeur.»
«A la conférence des maîtres de la rentrée, j’ai remarqué une grande inquiétude sur les visages des nouveaux qui débutent, se désole Nicole. Contrairement à d’autres années, les plus expérimentés n’avaient pas le cœur léger non plus.»
Tant de noirceur va-t-elle les inciter à quitter le métier? Pas tout de suite, répondent les enseignants. Mais ils ne vont pas rester profs toute leur vie. Françoise a envisagé un autre emploi l’année passée déjà. «Cela ne s’est pas fait. Tant pis. J’aime toujours enseigner, mais je souhaiterais le faire dans des meilleures conditions.» Car ce qui compte pour Françoise, Nicole, Julie et Bertrand, même victimes du vertige de la rentrée, c’est «d’être des bons pédagogues».
Par : Marco Danesi, Le temps, 23 août 2014






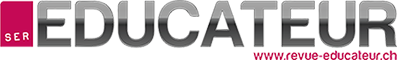

 Facebook
Facebook


