Georges Pasquier: «Toucher à l’éducation, c’est tailler dans notre matière première» (Migros Magazine, 25.08.2014)
Que pensez-vous de la décision du Grand Conseil thurgovien de supprimer l'apprentissage du français à l'école primaire?
«Le syndicat des enseignants romands l’a vu venir, puisque, le 30 novembre 2013, son assemblée des délégués appelait «les Cantons alémaniques (…), en application de la Constitution, à privilégier et assurer l'approche du français dès les premiers degrés de l'école». On n’apprend pas une langue à l’école, mais les langues nationales doivent être prioritaires. Le français est difficile pour eux, comme l’allemand est difficile pour nous, mais pour bien vivre ensemble, il faut faire des efforts.»
Cette rentrée scolaire 2014 ne semble pas placée sous de bons auspices...
On est très inquiet. Cette frénésie d’économies, due en partie au fait que la BNS arrête de verser ses dividendes, a créé la panique à bord. Les départements de l’instruction publique ont été les premiers visés vu qu’il fallait prendre des décisions immédiates en septembre.
Les coupes budgétaires touchent-elles également tous les cantons?
Oui. On sait qu’il y aura de grosses coupes en Valais, à Fribourg, Neuchâtel, Berne. Pour Genève et le Jura, ce n’est pas encore bien défini. Le seul qui s’en tire est le canton de Vaud, grâce à ce que certains appellent «l’effet Broulis».
La Suisse alémanique a l’air mieux lotie financièrement que la Suisse romande. Pourquoi?
Effectivement, pour l’école obligatoire, les investissements sont plus importants de l’autre côté de la Sarine. Mais je ne dis pas que les Alémaniques sont trop gâtés, ils ont aussi des restrictions et ils sont en plein dans l’harmonisation entre les cantons.
Concrètement, quelles incidences auront ces restrictions budgétaires?
Toutes les mesures ne sont pas encore décidées et elles sont disparates. On va enlever des heures d’appui par-ci, des pourcentages de poste par-là, ajouter un ou deux élèves par classe. Mais ces mini-coupes accumulées peuvent faire de gros dégâts. Le fait d’avoir une augmentation de 0,5 élève par classe semble ridicule au niveau du canton mais, concrètement, cela veut dire que dans telle classe, vous aurez tout à coup quatre élèves de plus.
» Toucher à l’éducation, c’est tailler dans ce qui est notre matière première en Suisse. C’est d’autant plus dangereux que c’est l’élève moyen qui va en pâtir. Ceux qui sont bien encadrés à la maison s’en sortiront toujours. Les départements ne viendront pas couper dans les structures d’aide mises en place pour les élèves en grande difficulté, parce que ce n’est pas politiquement correct. En revanche, tous les appuis et autres mesures d’encadrement instaurés pour les élèves moyens risquent d’être supprimés. Tout ça dans un contexte où le nombre d’élèves va augmenter…
Vous parlez d’augmentation des effectifs dans les classes. A partir de combien d’élèves est-ce trop?
Il n’y a pas de règle absolue. La classe qui m’a posé le plus de problèmes était une volée de seize. J’ai en revanche pu travailler de manière très satisfaisante avec une classe de vingt-neuf. On parle d’effectif moyen entre dix-neuf et vingt élèves, mais suivant les cantons, cela signifie des classes à vingt-huit ou à quatorze. Cette moyenne ne veut pas dire grand-chose.
L’Office fédéral de la statistique prévoit une augmentation de 50 000 élèves en 2022 et une pénurie d’enseignants. Pourquoi la Suisse peine-t-elle à trouver des professeurs?
La pénurie est criante dans les pays germanophones, Autriche, Allemagne… On est effectivement dans la phase critique où il va falloir remplacer la génération du baby boom qui part à la retraite. Et c’est vrai que le métier d’enseignant souffre d’un problème d’image. Le fait que cette profession se féminise signifie, hélas, sa dévalorisation. En 2004, au moment des réformes, l’école était très décriée, on tirait à boulet rouge sur le corps enseignant. Je crois que la compréhension de la difficulté de ce métier s’est un peu améliorée aujourd’hui, mais cela n’engage pas forcément les jeunes à y entrer…
D’après certains sondages, l’enseignant suisse a un statut social bas, contrairement à la Chine, par exemple, où il est l’équivalent d’un médecin. Comment expliquez-vous ce désamour?
C’est vraiment un problème de reconnaissance au niveau de la population. La question de la revalorisation est fondamentale. Quand vous prenez la Finlande qui cartonne dans les études PISA, c’est formation au niveau du master pour tout le monde, même pour les enseignants d’école enfantine. Et c’est file d’attente pour y entrer, alors que ce n’est de loin pas la profession la mieux rémunérée.
Vous avez dit: «Les parents sont aujourd’hui plus instruits que les enseignants». N’est-ce pas problématique?
C’est vrai qu’à la fin du XIXe siècle, l’enseignant était le seul qui savait écrire dans sa commune, il faisait partie des autorités. Au cours du XXe siècle, tout le monde, toutes professions confondues, a augmenté son niveau de formation. Si vous êtes dans un quartier défavorisé, le prof a encore un certain statut. Mais dans les quartiers aisés, ce n’est plus le cas. Tout le monde a sa petite idée de l’école, de ce qu’elle doit être. Cela veut dire que la profession manque d’une reconnaissance scientifique.
Il y aurait donc un problème du côté de la formation, que l’on qualifie souvent de «formation au rabais»…
Oui, la Suisse est un des seuls pays de l’OCDE avec une formation aussi courte. Comment voulez-vous préparer un généraliste en trois ans? A Genève, depuis que la profession est plus exigeante, il y a davantage de monde et d’hommes qui se présentent. Je suis certain que si l’on augmente les conditions de la formation, elle devient plus attractive. Certes, on a passé de cent cinquante instituts de formation à dix-sept HEP aujourd’hui. Mais le problème est que l’on a raté cette tertiarisation. Pourquoi? Parce que l’on a pris les écoles normales de l’époque, on les a repeintes en rose et on a écrit HEP dessus, sans changer le corps enseignant de ces instituts. Sans compter que l’on constate un tourisme de formation. Ce n’est pas valable. Si c’est un métier difficile, il faut un engagement des gens sur leurs compétences et leurs valeurs.
Et la mise en place du Plan d’étude romand, avec ses lourdeurs administratives, n’a-t-elle pas aussi contribué à éteindre des vocations?
Ce n’est pas lié. Les lourdeurs sont dues aux problèmes d’organisation de l’école. On a vu un développement exacerbé des contrôles de qualité jusque dans la fonction publique. Du coup, on fait remplir des fiches et des papiers aux profs plutôt que de miser sur la confiance.
»Le gros problème aussi est que l’on a hérité d’une école du XIXe siècle! Le contexte a changé, mais on travaille toujours avec le même outil: un enseignant, une classe. On a multiplié les appuis, mais ce n’est que du bricolage. On n’a pas relevé le défi. Autrefois, l’école apportait la connaissance, devait alphabétiser tout le monde et dégager une élite. Aujourd’hui, les sources de connaissance sont partout. Il faut plutôt développer un individu pour qu’il puisse se situer dans ce monde-là et savoir où trouver la connaissance. Il y a cinquante ans encore, 70% des élèves sortaient de l’école obligatoire et trouvaient du travail. Actuellement, celui qui sort de l’école obligatoire sans rien du tout est mort socialement. C’est toute l’organisation de l’école qui est à revoir.
En trente ans, qu’est-ce qui a changé dans le métier d’enseignant?
Mais tout le monde a changé, élèves, parents, enseignants. Il y a trente ans, il y avait un consensus éducatif. Les gens se levaient dans les trams pour les vieilles dames. Ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui, pour des raisons de diversité culturelle et par le fait que la société a viré sur le bonheur individuel absolu plutôt que le respect du voisin. A l’époque, l’école était une institution publique, reconnue, respectée, au service de tous. Aujourd’hui, l’école est devenue un service public, dont les parents attendent qu’elle fasse le bonheur de leur enfant et assurent sa réussite.
» Mais entendons-nous bien: je ne regrette pas un âge d’or qui n’a jamais existé, il faut faire avec l’évolution. Je dis seulement que les valeurs d’entraide encouragées par l’école sont à contre-courant des valeurs de la société, qui prône l’arrivisme. On est dans un monde qui n’est pas logique. Et qui est surtout extrêmement éclaté.
Et du côté des élèves, avez-vous constaté une évolution?
La part éducative de l’école a sérieusement augmenté. Souvent avant de mettre les élèves au travail sur le plan cognitif, il faut faire une part éducative pour qu’ils soient dans une condition d’apprentissage potable… On parle beaucoup dans les journaux de la violence à l’école. Mais je crois qu’il n’y a rien de bien nouveau, sinon des mentalités qui changent. Ce qui est peut-être marquant, c’est un moindre respect et un manque d’empathie des uns envers les autres. La violence psychologique via les réseaux sociaux est nouvelle, oui. Et dangereuse. Mais l’école, seul lieu d’apprentissage citoyen, peut y remédier en développant les valeurs de solidarité, de respect. Mais ça prend du temps, et il ne faut justement pas qu’on lui enlève les moyens budgétaires…
Est-ce qu’on se réjouit encore de la rentrée scolaire quand on est enseignant?
Oui, bien sûr. Quand vous passez trois heures avec vos élèves, que vous les avez en face de vous, vous oubliez tout!
Texte: © Migros Magazine - Patricia Brambilla






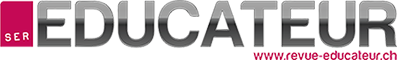

 Facebook
Facebook


